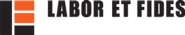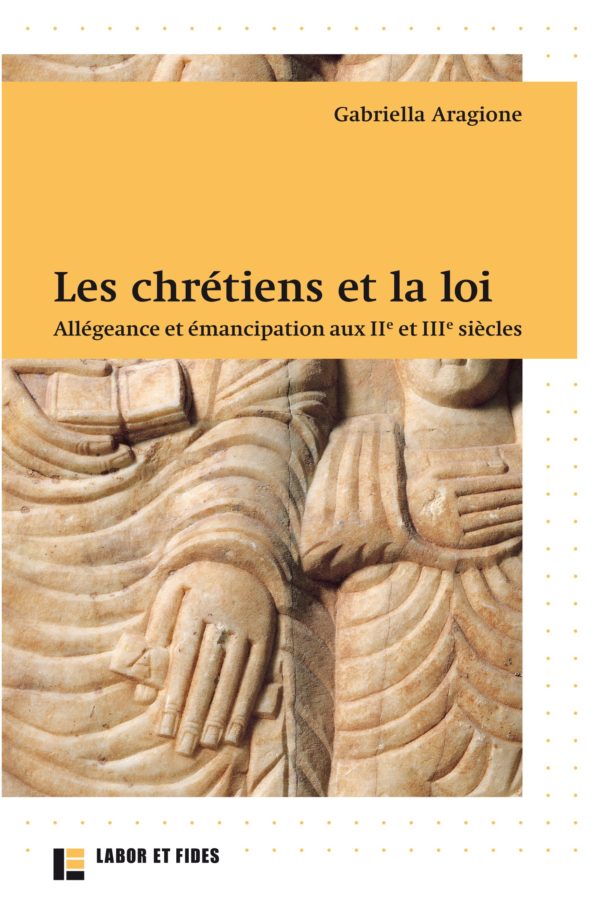Aux IIe et IIIe siècles de notre ère, un système de lois normatives régissait l’organisation générale de l’Empire romain. Les communautés chrétiennes durent se déterminer par rapport à lui, dans une tension entre respect et émancipation, au gré de visions plurielles relatives à l’articulation du lien entre le monde et Dieu. Le « nomos », un terme polysémique et aux importantes implications identitaires, pouvait désigner la coutume, les pratiques rituelles, la loi au sens juridique, la tradition, la façon habituelle d’être ou de se conduire. Nombre d’intellectuels chrétiens commencèrent à s’interroger sur les fondements de la société, sur la signification et le rôle des « nomoi » qui gouvernent les communautés, sur la valeur de la Loi mosaïque, dont le caractère « national » n’apparaissait plus adéquat pour une réalité présentée comme « supranationale ».
Cette recherche de Gabriella Aragione propose un panorama des divers positionnements chrétiens, de la distanciation marquée à sa sujétion étroite en passant par des essais de maintenir une identité propre sans pour autant dénier aux lois de l’Empire leur rôle de régulation. On peut ainsi observer dans ce livre que tous les scénarios ultérieurs relatifs au rapport du théologique et du politique sont déjà annoncés dès les premiers siècles de la civilisation chrétienne.